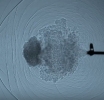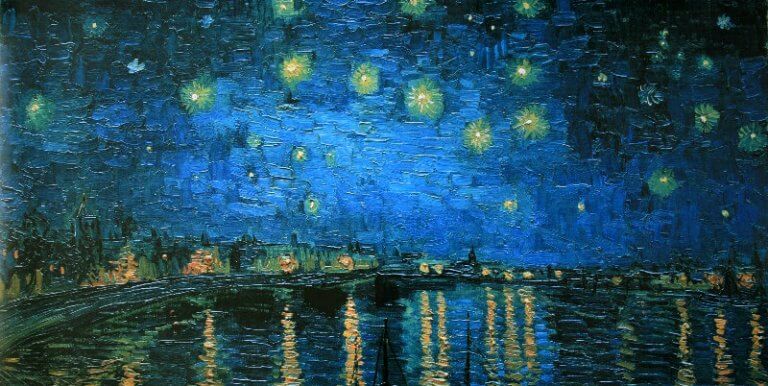Écrire : le défi des pleurs et des larmes
Illustration : La Descente de croix, Rogier van der Weyden (détail)
« C’est tellement mystérieux le pays des larmes… » Le Petit prince, Antoine de Saint Exupéry
Les larmes ne pourraient-elles pas, détrônant ainsi le rire, être proclamées le « propre de l’homme » ?
Quelles questions les larmes posent-elles aux relations humaines, sociales ou intimes et par là, à l’écriture ?
À la fiction ?
Les mots, le vocabulaire des pleurs
— Le « plorer » du Xe siècle, issu du latin plorare, « crier, se lamenter, gémir » devient « pleurer » au XIIe siècle : verser des larmes sous l’effet d’une douleur physique ou morale, d’une émotion violente.
Pleurs et larmes ces « « humeurs liquides qui s’écoulent d’une glande de l’œil » semblent déjà irréversiblement liés.
— Curieusement « larmer » a disparu, « pleurer » a pris toute la place, plus doux peut-être ? K. Huysmans, toujours friand de mots rares, l’utilise pourtant dans « En Rade ». Pour revenir peut-être à la réalité des pleurs ? À l’écoulement, au mouvement physique ?
Des expressions et des pleurs
On peut pleurer à chaudes larmes, verser toutes les larmes de son corps ou juste avoir la larme à l’œil, être bête à pleurer, verser des larmes de joie ou des larmes de crocodile, être sur le bord des larmes, pleurer comme un veau, pleurer amèrement, pleurer sur son sort, pleurer des larmes de sang, avoir des larmes dans la voix ou une crise de larmes, il existe des larmes qui nous brouillent la vue, on peut pleurer comme une Madeleine ou comme une fontaine, se rendre au bureau des pleurs, pleurer de rire, ou rire aux larmes, fondre en larmes (et voir changer de matière son corps ?) croire qu’en pleurant on pissera moins, avoir des larmes de joie, parcourir la vallée des larmes, être au bord des larmes, les ravaler quand elles nous montent aux yeux. Il reste encore le si poétique « Frôler les larmes »…
Finalement, il s’agit simplement « d’Être » en larmes. Puis, un jour, de sécher ses larmes.
L'imaginaire des mots du "pleurer"
Larme : un mot qui reste ouvert, comme en suspens. On y sent la larme apparaitre se gonfler, se détacher.
La larme, la goutte de chagrin, l’émotion matérialisée, un mot comme une sorte de bijou de souffrance.
Profondeur de l’émotion, matière délicate.
Transparence.
Elle se forme, se sépare, roule, il y a une vie de la larme.
Et puis objet-larme, objet de peintre - comme le tissu - peindre la larme, c'est faire une prouesse, montrer du savoir-faire, maitriser l’illusion de l’émotion, un exploit qui se place quelque part.. entre le sec et le larmoyant, entre l’absence de manifestation et son débordement qui lui faire perdre sa signification, sa force.
Il y a le torrent de larmes, et puis la larme unique, précieuse,une sorte de chagrin pur, essence de chagrin.
La larme, la goutte de chagrin s’écoule sur son chemin de joue.
Délicatesse ondoyante sur une peau parcheminé ou fruitée,
elle s’étire, marque le poids de l’émotion dans sa forme de poire tansparente,
lanterne magique ou se reflète l’âme
Manifestation, preuve ou mesnsonge.
Les pleurs, moins condensés que la pluie et sa douceur liquide. Pleurs, un mot qui se perd. Qui s'est perdu.
Est-ce que les animaux pleurent ? J'ai vu la larme d'une brebis couchée, mourante, tombée de la falaise. Larme du dernier souffle et de la souffrance. Coulée d'humanité ?
Du point de vue littéraire, pleurer éloigne, neutralise un peu. Les pleurs sont plus concrets et puis il y a la larme, l'arme, si proche de la lame.
La goute de chagrin, finalement, j'y reviens.
Et la physiologie des larmes ?
Liquide constitué essentiellement d’eau salée et ionisée, il existe trois sortes de larmes, toutes trois réflexes avec des mécanismes et des buts différents.
— Les larmes qui servent à humidifier, lubrifier, oxygéner nettoyer la cornée. Présentes en permanence, ce sont des sécrétions que nous partageons avec les animaux.
— Les larmes produites sous l’effet d’une agression extérieure par exemple le gaz dégagé par l’oignon ou une poussière dans l’œil. Porteuses d’anticorps et d’enzymes antibactériens, elles sont utiles pour défendre, protéger la cornée.
— Les larmes liées à une joie ou un chagrin, celles qui nous intéressent. Ces larmes sont aussi réflexes : des sécrétions liées aux émotions !
« Mais son cœur était soulagé, et de ses yeux coulaient des larmes qui tombaient sur ses mains ». F.Nietzsche
Une mutation génétique s’est produite dans l’espèce humaine il y a des centaines de milliers d’années. Une erreur a connecté le système limbique – les régions cérébrales qui ressentent, détectent et expriment des émotions – aux glandes lacrymales. Cette erreur s’est reproduite, un gène a muté et cette mutation a dû présenter des avantages puisque, la sélection naturelle ne s’en est pas débarrassée !
Si les animaux peuvent gémir, crier, hurler, aucun ne verse des larmes d’émotion, pas même nos plus proches cousins, les primates. Les pleurs renvoient à l’humanité ou peut-être est-ce l’inverse l’humanité s’est faite par les pleurs ?
"J’avance dans la ruelle des couloirs, raide dans ma tenue tel un GI mal costumé. Et puis sur le seuil de ta chambre, haut du cœur, haut du corps, le spasme, le même encore, le temps de l’étonnement douloureux, les larmes montent, leur marée pousse jusqu’au bout des yeux, le corps subit la vague. Je frissonne, une fois encore la vue s’embue. D’où vient ce flot si puissant que je me tétanise ?" Extrait de mon roman, L’Autre d’une femme.
L’origine des pleurs se trouve donc dans le cerveau. La tristesse est l’une des émotions dont les neuro scientifiques ont découvrent la nature chimique au travers du rôle des neurotransmetteurs qui se modifient face à une nouvelle grave, un choc émotionnel. Ces processus cérébraux, qui agissent un peu comme des antidouleurs, s’accompagnent de manifestations corporelles (gorge serrée, boule à l’estomac, respiration réduite) et parfois, ce message nerveux fait couler des larmes.
Elles ont une composition différente des autres larmes avec plus de protéines et d’hormones qui agissent sur la douleur. On retrouve également dans ce type de larmes les molécules responsables du stress ou des toxines apparues sous l’effet du stress.
On pleure beaucoup dans l’enfance, en vieillissant, on produit moins de larmes, on pleure moins, mais on peut larmoyer.
Quels sont donc les effets physiologiques des pleurs ?
Une sorte de catharsis physiologique : antidouleur, relaxation, élimination de toxines du stress…
Les larmes, sorte de protecteur psychique, nous laissent épuisés, à cause, bien sûr de la situation qui a provoqué les larmes, mais aussi de la libération d’hormones qui vont provoquer l’accélération du rythme cardiaque, la dilatation des vaisseaux sanguins et la production d’énergie à partir de nos réserves de glucose et d’acide gras, une dépense énergétique correspondant à une sensation de fatigue. Certaines théories affirment même que pleurer conduirait le corps à libérer des endorphines de bien-être, celles qui sont libérées par l’exercice ou le sport.
Il est vrai également que pleurer fait travailler des muscles habituellement peu mobilisés comme ceux du menton, de la poitrine ou de l’intérieur de la gorge.
Pleurer permet donc de retrouver un état d’équilibre émotionnel. Tous ces mécanismes contribuent à diminuer les tensions psychiques : tristesse, anxiété, angoisse, peur, y compris les tensions positives : joie, rire…
Vertu de libératrice des larmes ? Dimension physique et haute densité psychique !
« Pleure afin de savoir ! Les larmes sont un don. Souvent, les pleurs, après l’erreur ou l’abandon, raniment nos forces brisées ! » Victor Hugo
Pleurs et féminité
L’enjeu de genre ! Les hommes qui "ne pleurent pas" et puis se mettent à pleurer.
Les larmes contiennent des hormones de stress dont elles permettent de réduire la concentration dans le corps, en particulier la prolactine, hormone responsable de la lactation après l’accouchement, de l’absence d’ovulation et du déclenchement des larmes. La lactotransferrine, hormone régulant la production de lait, est aussi à l’origine de cette surproduction de larmes chez les femmes. On peut aisément imaginer que ces deux substances se trouvent en moins forte concentration chez les hommes ! C’est pour cette raison biologique que les femmes pleurent entre 4 et 8 fois plus que les hommes à l’âge adulte et elles pleurent plus longtemps et avec moins de retenue.
Habitudes sociales, codes culturels, éducation spécifique et biologie ne sont donc pas ici tout à fait étrangers…
Dans certaines cultures, « les pleureuses » sont encore appelées pour pleurer les morts. Pleurer est alors un travail, un rôle social aussi.
Une "histoire des pleurs" ?
Acceptées chez les soldats homériques et romains (Priam vient implorer Achille pour avoir le corps de son fils Hector, Achille pleure son ami Patrocle, les exemples sont très nombreux dans l'Iliade et l'Odyssée) les larmes sont, au Moyen-âge, fortement liées à la foi, à l’émotion spirituelle au travail de deuil. On observe un mouvement de laïcisation au XVIIe. Les larmes deviennent une preuve d’humanité et garantissent la valeur morale de celui qui les verse. Le siècle suivant, avec notamment Rousseau, loin de se contenter d’entériner cette évolution, la radicalise de façon saisissante en promouvant une véritable « morale du sentiment ». Désormais, ne pas pleurer dans des circonstances touchantes, c’est se montrer dépourvu d’une « sensibilité » donnée pour “premier fondement de la société et revient à s’exclure de la communauté vertueuse et à sombrer dans ce que le XVIIIe siècle nomme la barbarie.
En ce qui concerne l’art, c’est surtout la promotion du pathétique, conçu désormais comme catégorie esthétique autonome, qui, en donnant les moyens de penser un plaisir qui ose enfin s’avouer pour tel, débarrasse définitivement le langage des larmes de sa soumission à « une culture du refoulement ». Le pathétique devient progressivement, durant le dernier tiers du XVIIe siècle, “une catégorie esthétique à part entière, dégagée de toute visée morale ou religieuse”, il devient enfin possible de décrire librement, indépendamment de tout horizon éthique, dans le cadre d’une rhétorique adulte et désormais soucieuse de penser l’esthétique comme objet d’étude autonome, la volupté des larmes ! En instituant “la promotion esthétique de la sensibilité », cette autonomisation du pathétique favorise de façon décisive l’envahissement de bon nombre d’ouvrages du siècle suivant par le langage des larmes .
Le partage net entre un masculin qui ne pleure pas et un féminin associé au pleur facile, allant ainsi plus loin encore que la biologie, s’installe notamment à partir du XIXe.
Le langage des larmes
Il faut noter le lien des mécanismes des larmes avec le nerf facial, avec le nerf maxillaire supérieur, ce qui explique le surgissement d’expressions particulières, de mimiques spécifiques liées au fait de pleurer. Les larmes forment ainsi une partie d’une expressivité globale de la souffrance et de la douleur.
Des formes primitives (signal de douleur ou de détresse), les pleurs sont devenus une forme de communication élaborée dont on peut penser qu’elle a contribué à renforcer les liens sociaux et ainsi à permettre à nos ancêtres de survivre et de prospérer. Il peut prendre le relais du langage verbal : on peut pleurer sous le coup d’une émotion qu’on ne peut parvenir à verbaliser, lorsque “les mots ne viennent plus.”
Le langage des larmes, considéré comme un système de signes “muets”, assure une communication dans un environnement socioculturel donné : il dépend d’un système de règles, de normes et de modes en vigueur à une certaine époque et dans une certaine culture.
Grâce à nos larmes, l’autre peut capter le message de souffrance, le degré d’émotion que nous vivons. Là où nous n’avons plus ou peu de mots, les larmes prennent en charge la communication humaine et permettent, d’autant plus que l’interlocuteur est à l’écoute, un ajustement de ses réponses envers l’autre, favorisant par là même un échange empathique.
Le lien entre pleurs et visage est devenu un élément essentiel de la communication : un moyen crucial de déchiffrement de l’émotion, de la douleur de l’autre.
Les larmes s’écoulent et c’est comme si quelque chose de l’intériorité se matérialisait.
Les larmes : vulnérabilité ou moyen de pression ?
“À lire nos anciens, il semble que les hommes aient beaucoup pleuré. Ce n’est plus de mise. Il n’est pas grand monde pour larmoyer dans les romans contemporains comme dans la vie. Cette effusion est mal vécue. L’époque se veut cynique. Sous le prétexte d’une affreuse pudeur, on aura rayé, en condamnant les larmes, ce dernier signe corporel des vastes émotions incompressibles dans de si petits corps. Le mâle surtout, et mystérieusement, n’a plus ce droit. Il sera bientôt réduit à sa plus simple expression. Il bande, éjacule et meurt – activité de gibet.
Je n’ai pas eu cette chance. Je suis des rares qui osent encore. J’en suis à mon quatorzième lacrymatoire gallo-romain offert en cadeau de rupture. C’était ce matin, au réveil, après avoir écouté une nouvelle fois la chère voix de Rodogune au téléphone j’ai fini par sangloter – l’émotion vibrante m’épuise, comment arriver jusqu’à la Nuit, par quel chemin et dans quel état ?” Michel Castanier
Les larmes, sécrétions réflexes (sauf chez certains comédiens ou antiques pleureuses), nous livrent, nous libèrent, nous servent, nous révèlent, nous rendent perceptibles. Elles posent la question de la passivité / l’activité, de la force /la faiblesse. Par nos larmes, nous apparaissons dans notre vulnérabilité : pleurer c’est montrer une perte de contrôle sur nos émotions, une perte de défense. Laissant de côté le monde des apparences, de la bienséance, les larmes sont parfois des moments de vérité.
“PLEURER. Propension particulière du sujet amoureux à pleurer : modes d’apparition et fonction des larmes chez ce sujet.
Je, moi qui pleure toutes les larmes de mon corps” ? ou verse à mon réveil “un torrent de larmes” ? Si j’ai tant de manières de pleurer, c’est peut-être que, lorsque je pleure, je m’adresse toujours à quelqu’un, et que le destinataire de mes larmes n’est pas toujours, Je même : j ’adapte mes modes de pleurer au type de chantage que, par mes larmes, j’entends exercer autour de moi.
En pleurant, je veux impressionner quelqu’un, faire pression sur lui (“Vois ce que tu fais de moi”). Ce peut être - et c’est communément - l’autre que !” on contraint ainsi à assumer ouvertement sa commisération ou son insensibilité; mais ce peut être aussi moi-même : je me fais pleurer, pour me prouver que ma douleur n’est pas une illusion : les larmes sont des signes, non des expressions. Par mes larmes, je raconte une histoire, je produis un mythe de la douleur, et dès lors je m’en accommode : je puis vivre avec elle, parce que, en pleurant, je me donne un interlocuteur emphatique qui recueille Je plus « vrai » des messages, celui de mon corps, non celui de ma langue : « Les paroles, que sont-elles ? Une larme en dira plus. » »
Roland Barthes, Éloge des larmes
Sincérité des pleurs?
Larmes de crocodile : voici l’expression qui pose le soupçon sur les pleurs ! Elle proviendrait d’une légende de l’antiquité dans laquelle les crocodiles, cachés dans les hautes herbes du Nil, auraient attiré leurs proies par des gémissements et des plaintes. Une autre explication, moins poétique, affirme que, lorsque le crocodile ouvre très grand sa mâchoire pour croquer sa proie, il appuierait sur ses glandes lacrymales, déclenchant la production de larmes.
Quoi qu’il en soit, ces deux explications ramènent au fait que les larmes de crocodile n’ont rien à voir avec une tristesse sincère, mais qu’elles illusionnent, cherchant à émouvoir de façon hypocrite quelqu’un pour le tromper.
Le soupçon de duplicité de dissimulation et de mensonges existe depuis les premiers moralistes. Les larmes, fausse faiblesse et vraie puissance, se révèlent de formidables machines de manipulations de l’autre. L’extériorisation des sentiments, des émotions, peut être un moyen de pression, de culpabilisation.
Sur le plan physiologique déjà, les pleurs dégagent un signal chimique volatil dont la perception par un autre individu, par le biais des récepteurs de l’olfaction serait à l’origine d’un effet sur son état d’esprit. On peut rappeler qu’une équipe de chercheurs du Weizmann Institute of Science, en Israël, a pu démontrer que les larmes des femmes envoient des signaux chimiques volatils, qui entraîneraient une chute de la testostérone chez l’homme, induisant par là même une baisse de libido.
Les larmes comme une arme ?
Voici une sorte de « nouvelle tendance » que j’ai trouvée dans plusieurs livres et émissions récentes : les larmes comme arme politique. En voici un exemple dans un livre qui vient de sortir
« L’Amour et la révolution » de Johanna Silva, l’ex-compagne et ex-attachée parlementaire du député de la Somme François Ruffin :
« J’avais un nouveau cheval de bataille qui m’était propre : je voulais défendre l’humanité, la vulnérabilité, la bienveillance au sein du monde politique. Je sentais bien que ce n’était pas une niaiserie, qu’il y avait quelque chose à creuser. (…) J’en étais même venue à considérer mes pleurs intempestifs comme une arme. » Un rapport aux larmes, une vision des larmes, qui fait réfléchir…
Quelques pistes d'écriture des larmes et de réflexion...
— Mystère du surgissement, de la matière, de l’odeur des larmes
Forme des pleurs : sanglots ? Écrire comme des sanglots ? Poétique des larmes ?
— Le moment des pleurs : immédiat, l’après-coup. Moment de pleurer ou pas ? Trop tard ? Sa durée ? Trop long ? Trop bref ?
— Retenir, garder, refouler ? Surgissement des larmes : « être pleuré ? »
— Être l’otage, captif de ses larmes ?
— Épanchement, faiblesse, vulnérabilité. Répandre des larmes : pleurer, pleurnicher, s’épancher.
— Laisser couler ses larmes, s’autoriser, ne pas même les sécher ou les réprimer.
— Être submergé, débordé.
— Fonte de l’identité sociale et personnelle qui craque, qui fond ?
— Maitrise, souveraineté de soi ou sa disparition.
— Censurer. Larme et volonté ? Aveu de faiblesse ou rage ?
— Libérer, accueillir les pleurs
— Pleurer = s’humaniser ?
— Jamais seul quand on pleure ?
— Pleur solitaire. Pleur privé, intime ? Se cacher. Larme et pudeur. Intimité des larmes et pourtant manifestation extérieure
— Pleur et relation amoureuse ou amicale
— Parler avec ses larmes, se taire et dire ?
— Refus de voir l’autre pleurer.
— Afficher ses pleurs comme un reproche.
— Demander par les larmes : implorer, de justice de réparation.
— S’excuser de pleurer
— Prise de pouvoir : attendrissement, culpabilisation.
— Appel à l’autre. Faire pression ou subir ?
— Pleur social et dimension culturelle.
— Émotion publique ou privée
— Travail et temps du deuil. Pleurer les morts.
— Les larmes du quotidien, la « vie embuée ? »
— Déplorer : ressassement, lamentation.
— Solidarité, contagion des larmes ? Communion par les larmes : pleurer avec, pleurer ensemble.
— Pleurer au cinéma ou au théâtre. Catharsis ?
— Politique et poétique, transformer le réel ou une relation ?
Pas simplement une expérience de douleur : demande de consolation ou de justice, d’une future réparation
— Larme comme arme politique ?
— Absence, fin des larmes. Sécher ses larmes
— Ne plus savoir pleurer ? Être bloqué.
— Bonheur de pleurer dans un film de Truffaut : l’enfant avoue que pleurer, c’est un bon petit plaisir !
— Métaphysique des larmes ?
« Au jugement dernier, on ne pèsera que les larmes ». Cioran.