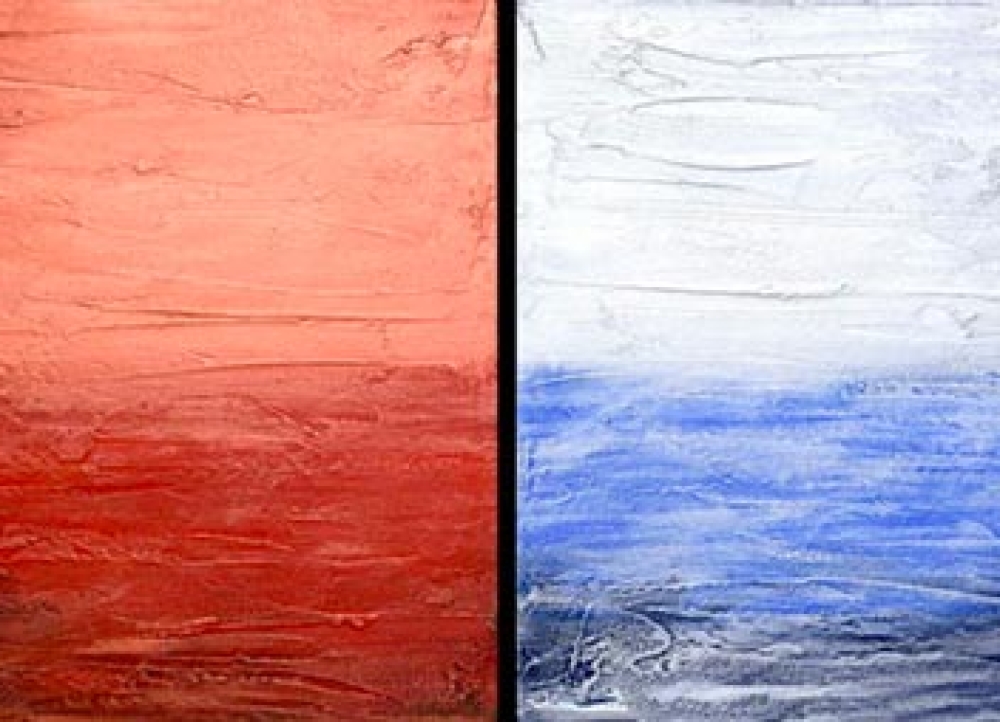Il s’agit ici de textes dont le sujet est une couleur, non pas dans son utilisation descriptive, mais la couleur elle-même dans ses dimensions symboliques, psychiques et existentielles, des textes remarquables par l'intensité et la densité de leur expression et la force des enjeux qui y sont à l’œuvre.
– Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline
Un texte avec quelques indications de contexte, une situation qui se devine, une exploration de l’angoisse, du sentiment de l’absurde au moyen de la couleur qui se fait présence oppressante, presque palpable.
« Le noir, c’était pas seulement la nuit, c’était autre chose, quelque chose de plus lourd, de plus épais. Un noir qui s’infiltrait partout, dans les murs, dans les poumons, dans les pensées. Ce n’était pas l’absence de lumière, non, c’était une présence, une matière qui pesait sur les épaules, qui collait aux semelles, qui bouchait les yeux. Ce noir-là, je l’ai vu dans les tranchées, dans les regards des hommes qui n’espéraient plus rien, dans le fond des verres vides qu’on laisse sur la table. Il n’avait pas de forme, mais il avait un goût, un goût de cendre et de ferraille, un goût qui restait dans la bouche des années après. Le noir, c’était la guerre, c’était la peur, c’était tout ce qu’on ne dit pas et qui vous étouffe quand même.»
— Le Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa, écrivain et poète portugais
Le noir sans aucun contexte comme absence métaphysique, un paradoxe philosophique, couleur de l’intériorité fragmentée et du vide existentiel.
« Le noir n’est pas une couleur, c’est le néant qui se pare de formes pour nous tromper. C’est un noir si dense qu’il absorbe la lumière sans la rendre, un vide qui se remplit d’échos intérieurs, de ces pensées qui tournoient comme des ombres dans une pièce sans fenêtres. Je l’ai contemplé dans les nuits d’insomnie, où il s’étend non seulement sur le ciel, mais sur l’âme elle-même, un noir velouté qui caresse et étouffe à la fois, qui dessine les contours d’un moi absent. Il n’est pas froid, ce noir ; il est tiède comme un manteau usé, imprégné des regrets et des possibles avortés, un noir qui murmure des secrets inavouables, qui teinte les rêves d’une opacité fertile. Dans ce noir, tout se fond : les souvenirs deviennent taches indélébiles, les espoirs se dissolvent en encre invisible. Il est le berceau de l’intranquillité, cette couleur qui n’éclaire rien mais révèle tout, en nous laissant face à notre propre obscurité, infinie et complice.»
« Le blanc est une couleur qui n’en est pas une. C’est un silence, un vide qui contient tous les possibles et aucun à la fois. J’ai vu le blanc dans les matins d’hiver, quand la lumière refuse de se lever, quand le monde semble suspendu dans une attente infinie. Ce n’est pas le blanc du papier, ni celui de la neige, mais un blanc plus profond, un blanc qui avale les formes, qui dissout les contours, qui efface jusqu’à l’idée même de contour. Ce blanc-là, je l’ai senti dans mes pensées, dans ces moments où l’âme se tait, où elle se perd dans une contemplation sans objet. Il est effrayant, ce blanc, parce qu’il est tout et rien, parce qu’il est le miroir où je ne vois que moi-même, et où je ne me vois pas du tout.»
Voici des exemples portant un peu moins nettement sur une couleur de façon générale, une réflexion plus liée à un contexte, un lieu, un objet :
– La Route des Flandres de Claude Simon
Le vert, la force immersive de la forêt, devient un espace, une mémoire.
« Le vert n’était pas une couleur, c’était un monde. Un vert qui ne se contentait pas d’être vu, mais qui s’imposait, qui vous enveloppait, qui vous avalait tout entier. C’était le vert des forêts d’août, un vert si saturé qu’il semblait suinter, goutter, respirer comme un être vivant. Il y avait dans ce vert des éclats d’émeraude, des ombres de jade, des reflets de mousse humide, et pourtant il était plus que tout cela, il était une présence, une mémoire, un temps arrêté. Ce vert-là, je l’ai porté dans mes yeux longtemps après avoir quitté les bois, il s’était incrusté en moi, comme une tache indélébile, comme un souvenir qui ne veut pas mourir. Il me parlait de la guerre, de l’attente, des hommes perdus dans les feuillages, de tout ce que la forêt avait englouti et ne rendrait jamais.»
– Les Nuits de Paris de Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne (1788-1794)
Rétif de la Bretonne est un écrivain libertin, prolifique -et oublié!- du XVIIIe siècle, éclipsé par ses contemporains comme Diderot.
« Le vert des feuillages nocturnes n’était pas un simple voile sur la ville ; c’était une respiration, un murmure qui s’infiltrait dans les veines des pavés humides et des âmes errantes. Ce vert-là, saturé d’humidité et de secrets, se dégradait en nuances infinies : du jade profond des haies du Palais-Royal, où les amants se frôlaient sans se voir, au vert acide des lanternes éteintes, qui teintait les visages d’une jalousie végétale. Il n’était pas statique, ce vert ; il pulsait avec le sang des intrigues, s’épaississait dans les recoins des allées sombres, où l’on sentait son goût âpre sur la langue, comme une herbe fraîchement foulée. Il enveloppait Paris d’une tunique vivante, un manteau de feuilles qui cachait les vices et révélait les rêves, un vert qui n’appartenait ni au jour ni à la nuit, mais à ce limbe où les corps se cherchent dans l’obscurité complice. Longtemps après, ce vert me hantait, imprégné dans mes vêtements, dans mes souvenirs, comme une teinte indélébile qui colorait l’absence elle-même.»
– L’Amant de Marguerite Duras
La couleur du Mékong et du ciel se mêle à une méditation sur le désir et la mémoire. Le bleu devient une entité hypnotique et insaisissable.
« Le bleu du fleuve n’était pas un bleu ordinaire. C’était un bleu qui portait en lui la chaleur du jour, un bleu qui vibrait sous le soleil, un bleu qui semblait vivant, gorgé de reflets d’argent et de boue. Ce bleu-là, je l’ai regardé jusqu’à ce qu’il devienne une partie de moi, jusqu’à ce qu’il dissolve les contours de mon corps et de mes pensées. Il n’était pas seulement dans le fleuve, il était dans l’air, dans l’horizon, dans le tremblement des feuilles au loin. Ce bleu, c’était l’amour, c’était l’attente, c’était l’absence. Je l’ai porté en moi longtemps après avoir quitté la rive, comme une tache dans l’âme, une tache qui ne s’efface pas.»
– Clair-obscur de François Migeot (2013)
Dans ce recueil inspiré des pièces pour piano de Brahms, François Migeot, poète contemporain, explore le jaune comme une lumière incertaine, entre ombre et révélation.
« Le jaune surgit non comme une couleur, mais comme un frisson de la lumière elle-même, un éclat qui hésite entre le jour et l’ombre, entre le son d’un piano qui s’éteint et celui qui naît. C’est un jaune pâle, filtré par les rideaux d’une chambre d’hôtel oubliée, où les murs suintent une humidité dorée, un jaune qui se dépose sur la peau comme une poussière d’or fané, évoquant les pages cornées d’un livre lu à la bougie. Il n’est pas joyeux, ce jaune ; il est teinté de mélancolie, de ces heures creuses où le temps semble se dissoudre en filaments lumineux, en traînées qui rampent sur le sol de bois craquant. Dans ce jaune, je sens le poids des notes de Brahms, graves et suspendues, qui colorent l’air d’une attente infinie, un jaune qui avale les contours des objets pour ne laisser que leur essence fragile, comme un souvenir qui s’effiloche au réveil. Il persiste, ce jaune, tapi dans les plis des draps, dans les silences entre deux accords, une couleur qui n’illumine pas mais questionne, qui fait du clair-obscur non une opposition, mais une fusion intime, un murmure où l’âme se perd et se retrouve.»
– Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes (fin XIIe siècle)
Chrétien de Troyes, précurseur du roman arthurien, dans ce passage sur le Graal, pose le rouge comme symbole féminin et mystique.
« Le rouge du Graal n’était point un rouge de sang ou de vin, mais un rouge vivant, un carmin qui pulsait comme un cœur battant au centre de la salle obscure. C’était un rouge si pur qu’il semblait suinter des parois de l’écuelle d’or, un rouge qui se répandait en nappes fluides, teignant l’air d’une chaleur intérieure, d’une passion qui n’appartenait ni au corps ni à l’esprit, mais à l’âme en quête. Il évoquait les lèvres des dames de la cour, rougissantes sous les regards, et les flammes des cheminées où les chevaliers forgeaient leurs serments. Ce rouge-là ne s’éteignait pas ; il s’intensifiait dans l’ombre, devenant pourpre profond dans les replis du tissu qui le voilait, un rouge qui chuchotait des mystères païens et chrétiens mêlés, un appel à la pureté par le feu de la chair. Longtemps après la vision, ce rouge hantait Perceval, imprégné dans ses veines comme une tache sacrée, une couleur qui guidait ses pas vers l’inconnu, éternelle et dévorante.»
– Écrire la couleur : un défi poétique de Liliane Louvel (2002)
Une autre approche : la couleur chez un artiste, le bleu comme « défi » linguistique, inspiré de Cézanne et la couleur devient un enjeu inter-artistique, reliant peinture et littérature. La dimension de critique d’art laisse toutefois la part belle à une quête personnelle de la couleur.
« Le bleu de Cézanne n’est pas un bleu donné ; c’est un bleu conquis, un azur qui se bat contre le vert des feuillages pour émerger, pur et insaisissable. C’est un bleu qui vibre dans l’air de Provence, un bleu ciel qui descend jusqu’au sol en traînées légères, comme si la montagne elle-même respirait cette teinte, l’expirant en volutes subtiles. Il n’est pas statique : il palpite, se nuance en indigo profond dans les creux des vallées, en turquoise clair sur les crêtes érodées par le vent. Ce bleu-là, je l’ai poursuivi dans les mots, cherchant à le capturer sans le figer, car il fuit comme l’eau entre les doigts, un bleu qui évoque non la mer, mais l’infini d’un regard levé vers un horizon qui recule. Il colore l’âme d’une attente, d’un silence habillé de ciel, un bleu qui n’est ni joie ni tristesse, mais le seuil d’un monde où les formes se dissolvent en pure sensation, en une lumière qui n’éblouit pas mais enveloppe, persistante et éternelle.»